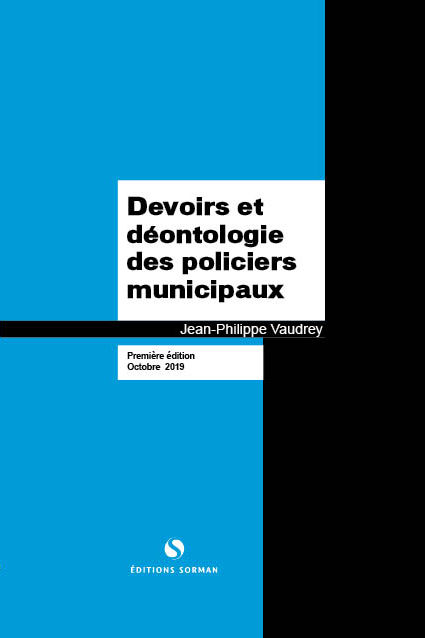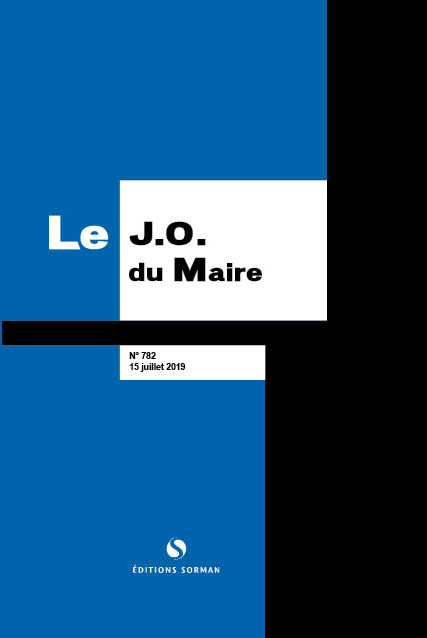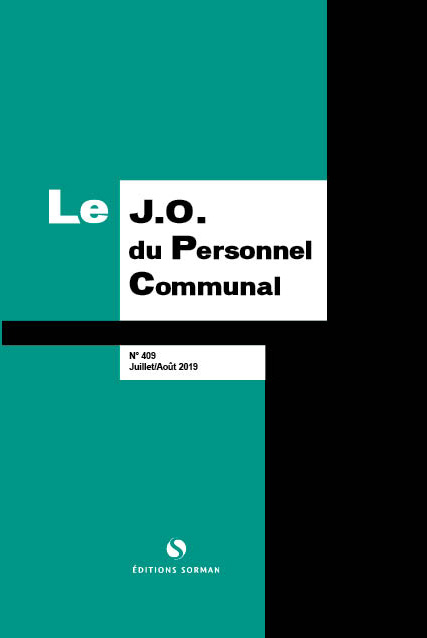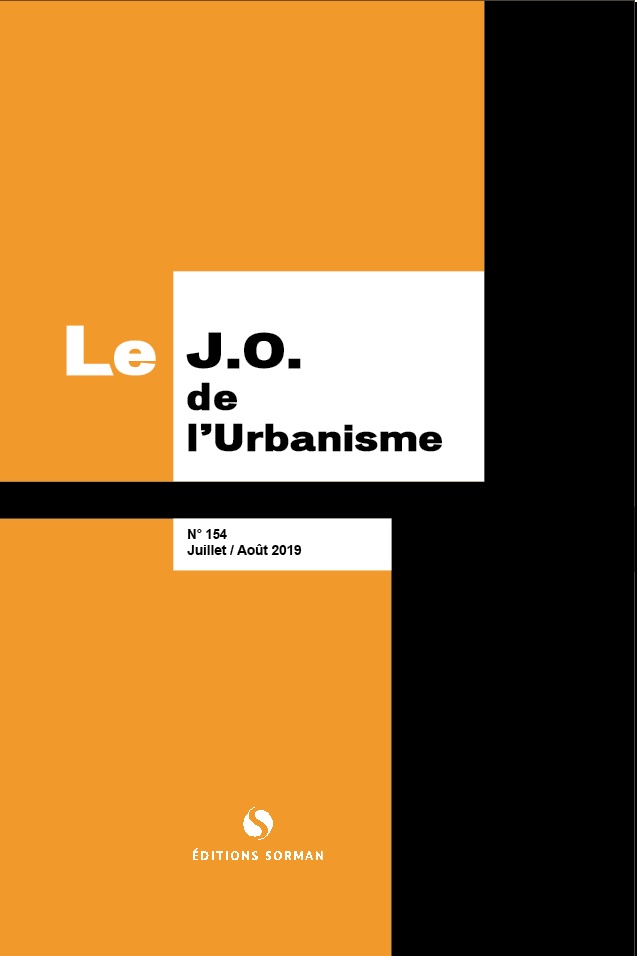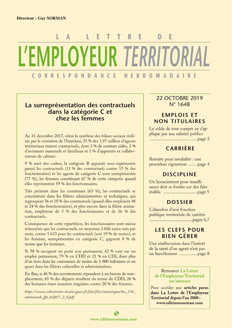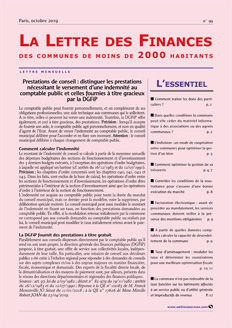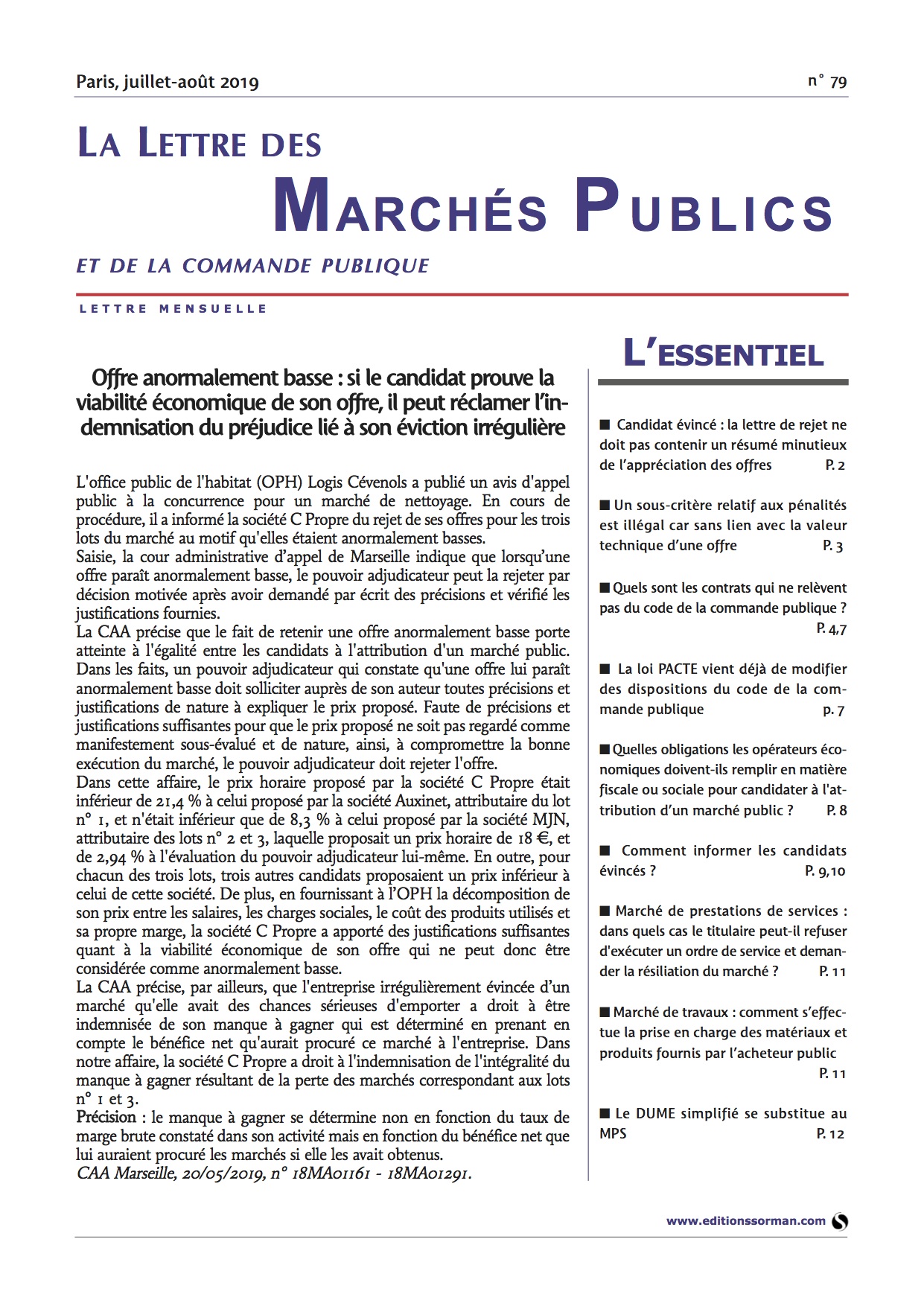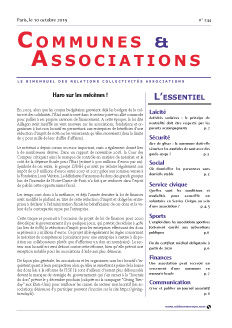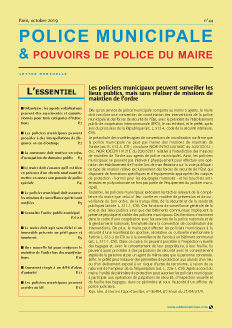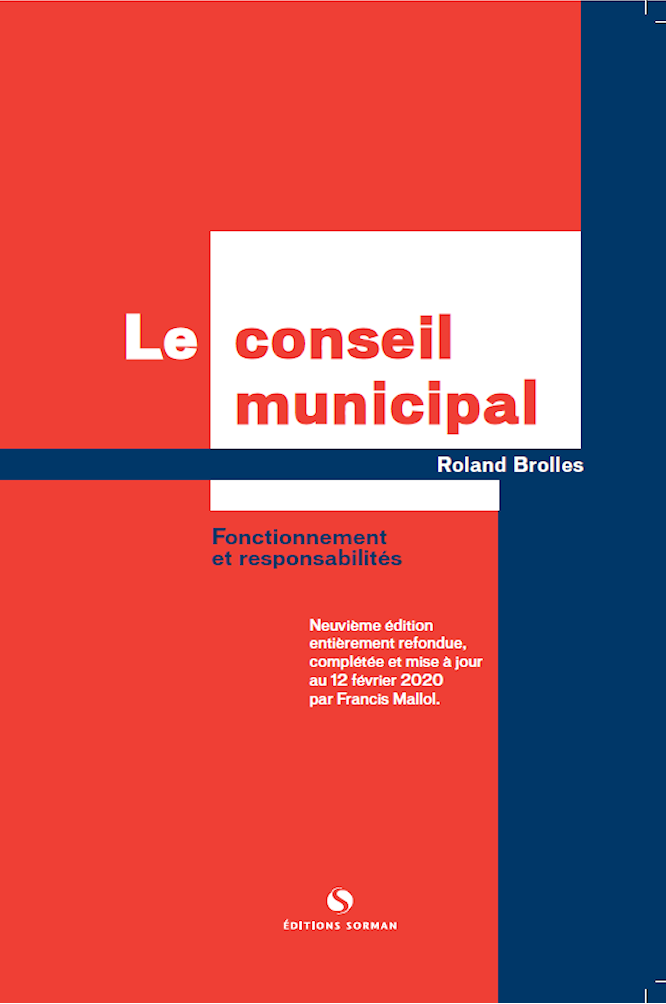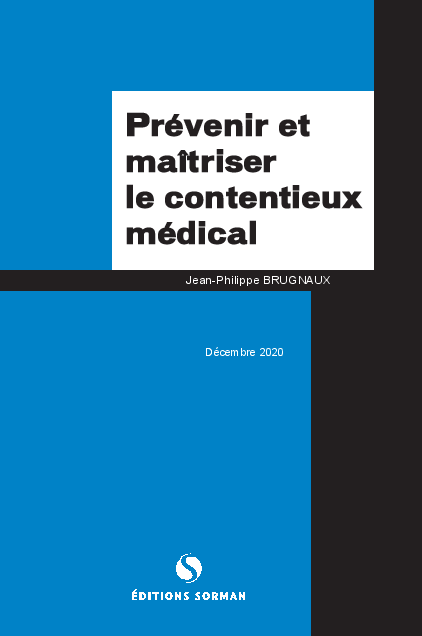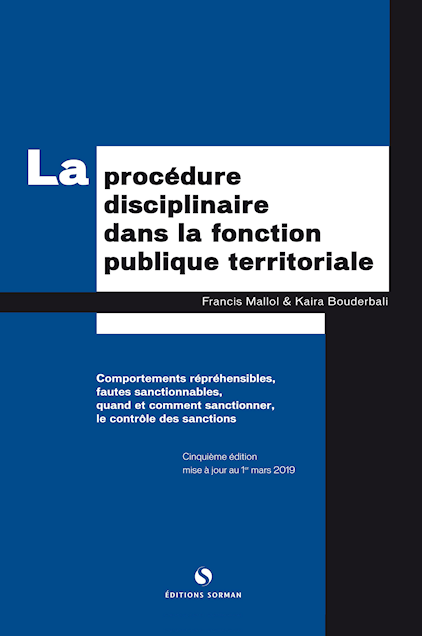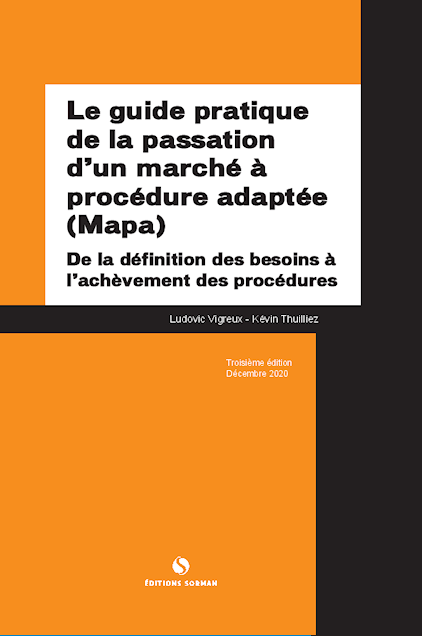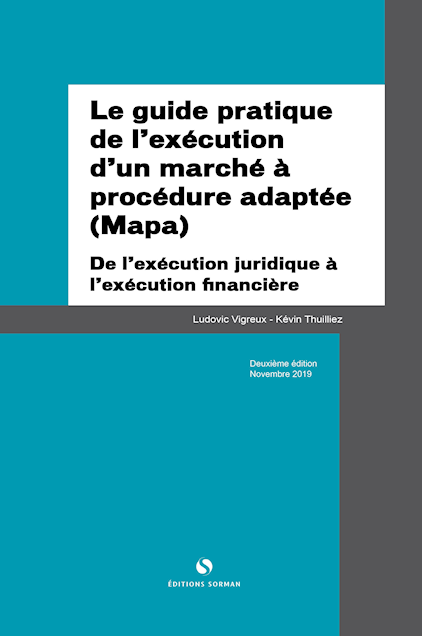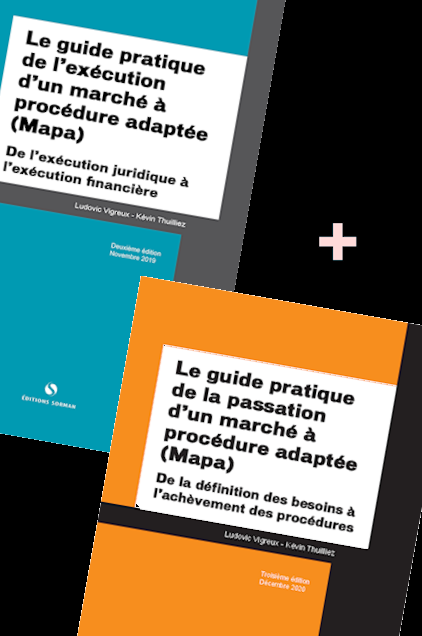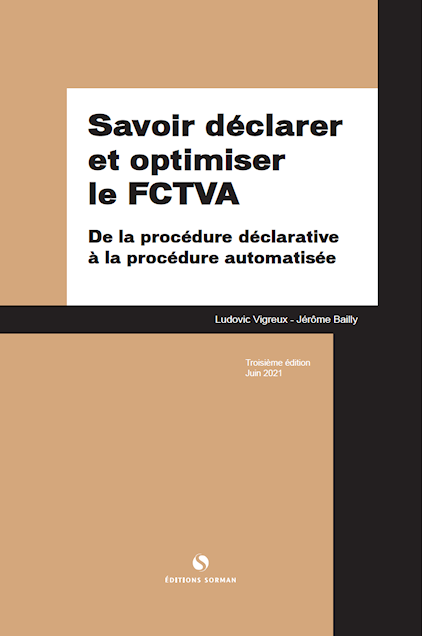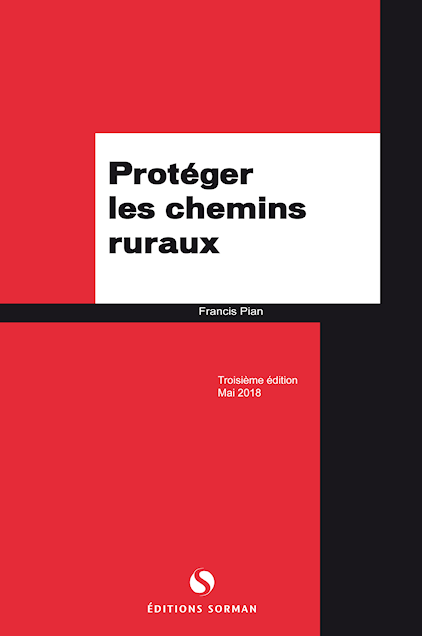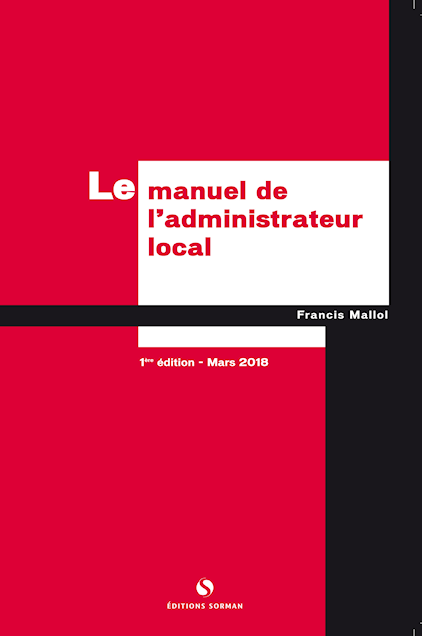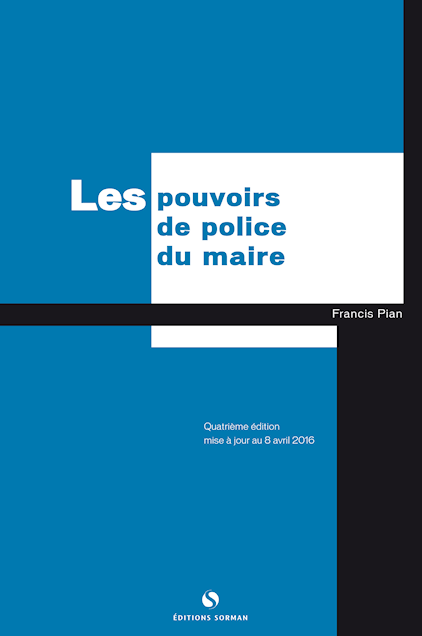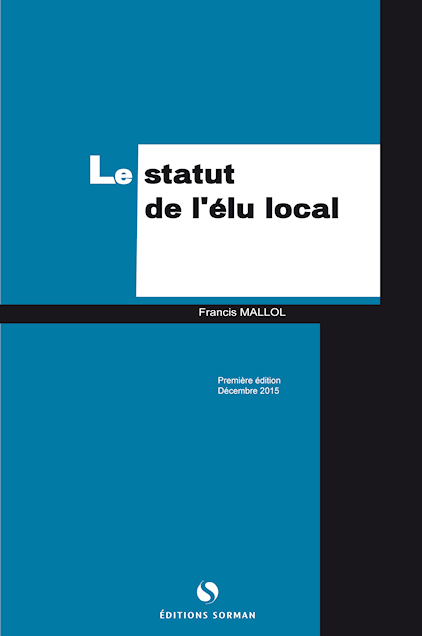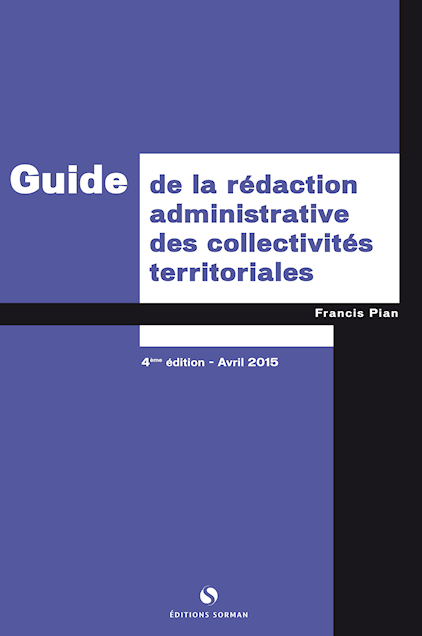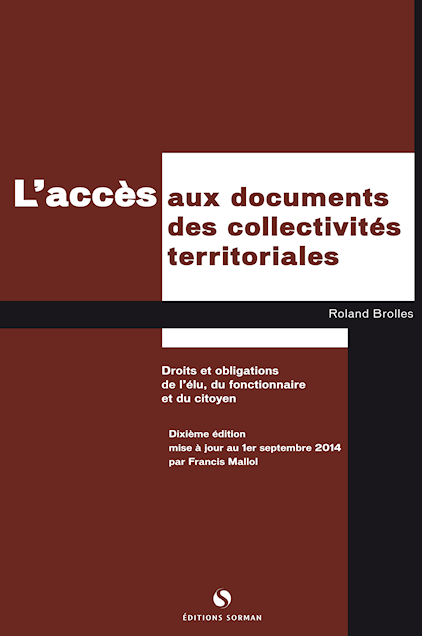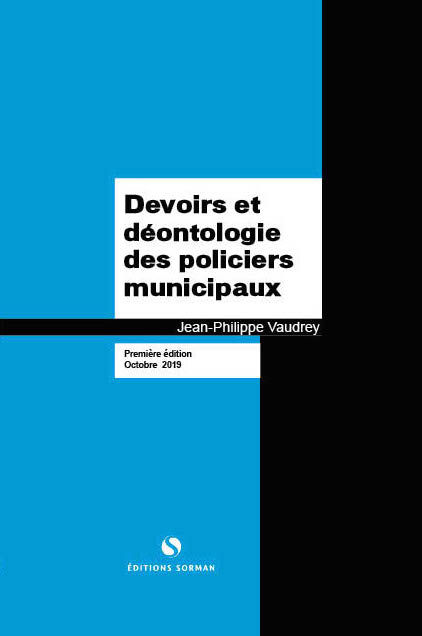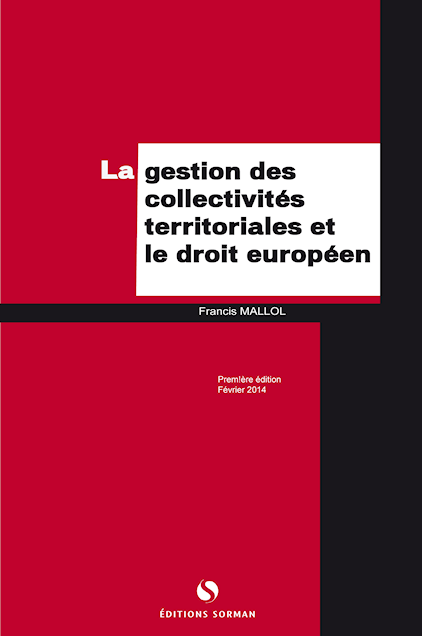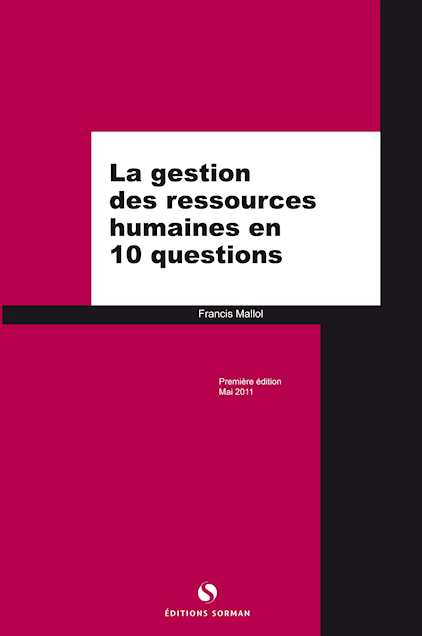Comment réaliser et financer des travaux sur un monument historique Abonnés
Le principe du programme
Le contenu du programme conditionne et encadre le travail de conception du projet.
Dans le programme, la commune doit définir les objectifs de l'opération et les besoins à satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage.
Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par la commune avant tout commencement des études de projet.
Le contenu du programme
Le programme doit comporter au minimum les éléments suivants :
- les données et les contraintes du site (environnement urbain ou naturel), du terrain (dont les relevés et l’étude de reconnaissance des sols) ou des existants (dont les diagnostics), des réglementations (urbanistiques, techniques…) ;
- les besoins exprimés sous forme quantifiée (inventaire et typologie des espaces, équipements) ;
- les besoins exprimés en terme de fonctionnalité (ergonomie) et de confort (hygiène, lumière, bruit…) ;
- les attentes d’ordre culturel, social, urbanistique et esthétique et d’ordre environnemental ;
- les exigences concernant les délais et phasages de l’opération, les coûts d’investissement, la maîtrise des dépenses d’exploitation et d’entretien ;
- le montant de l’enveloppe financière.
Conseil : lors de cette phase importante, la commune à tout intérêt à prendre l'attache des services de la Conservation régionale des monuments historiques (CRMH) et du Service territorial de l'architecture et du patrimoine (STAP) qui apportent leur expertise et leur conseil sur les procédures à suivre et les objectifs à atteindre. En outre, la CRMH a pour mission de communiquer l'état de la documentation qu'elle détient sur le monument au maître d'œuvre auquel seront confiés les travaux.
Attention : pour les édifices cultuels, la commune doit associer les autorités religieuses à l'élaboration du projet et prendre toutes mesures de protection et de sécurisation du mobilier avant la mise en œuvre du chantier.
Pour les édifices classés, la commune doit transmettre au préfet de région le programme accompagné du diagnostic de l'opération (décret n° 2009-750 du 22/06/2009).
Les travaux donnent lieu à une concertation préalable avec la Drac
Avant d'engager une opération de travaux sur un immeuble classé, la commune propriétaire du monument historique doit informer la direction régionale des affaires culturelles (Drac), et notamment le service de la conservation régionale des monuments historiques (CRMH), en communiquant le programme. La concertation préalable est obligatoire pour les immeubles classés ; bien que facultative pour les immeubles inscrits, cette procédure est toutefois fortement recommandée.
Précision : cette saisine est un préalable aux opérations de travaux et ouvre le processus de concertation avec la Drac.
Intérêt : la consultation de la Drac, lors de l'élaboration du programme des études et lors de l'avant-projet sommaire (APS) pour un projet complexe, permet de bénéficier du contrôle scientifique et technique en amont.
Attention : si la commune ne réalise pas de concertation préalable, elle s’expose à un refus de la Drac lors du dépôt de la demande d’autorisation des travaux.
La concertation peut se poursuivre jusqu'à l'avant-projet définitif (APD), qui permet de présenter la demande d'autorisation de travaux.
La commune doit bénéficier d’une autorisation de travaux
La procédure diffère selon que l’immeuble soit classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
1 - Le cas d’un immeuble classé
Les travaux sur un immeuble classé au titre des monuments historiques ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis de construire mais à une autorisation administrative particulière accordée par le préfet de région.
Attention : la commune ne peut pas détruire, déplacer, même en partie, un immeuble classé ; de plus, un tel immeuble ne peut pas faire l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification sans autorisation préalable.
Le maire ne peut pas réaliser n’importe quelle catégorie de travaux sur un monument classé. Ainsi, les travaux pouvant être réalisés sur un monument classé sont les suivants :
- affouillements, déboisement, défrichage, dessouchage sur un terrain classé,
- consolidation, aménagement, restauration, mise aux normes, assainissement, ravalement,
- sur les parties intérieures classées : modification des volumes ou des distributions horizontales ou verticales, modification, restauration, restitution ou création d'éléments de second œuvre ou de décors, sols, menuiseries, peintures murales, badigeons, vitraux ou sculptures,
- installations temporaires d'une surface supérieure à 20 m² et d'une durée supérieure à 1 mois sur un terrain classé.
La commune doit réaliser la demande d'autorisation au moyen du formulaire cerfa n°13585*01 ; cette demande est transmise en 4 exemplaires au service territorial de l'architecture et du patrimoine (Stap), dans le département duquel se trouve l'immeuble, soit par remise directe contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Attention : en cas de travaux pour l'implantation sur un immeuble classé de constructions ou d'installations temporaires de plus de 20 m² et d'une durée supérieure à 1 mois, la commune doit utiliser le formulaire cerfa n°13587*01.
Le préfet de région dispose d’un délai de 6 mois pour prendre une décision d'autorisation ou de refus, sauf si le ministère en charge de la Culture décide de se prononcer (le délai d'instruction est alors de 12 mois).
Attention : le préfet instruit le dossier en liaison étroite avec la Drac, d’où l’intérêt de la procédure de concertation préalable ; en effet, lorsque la commune a réalisé une concertation préalable, même lorsque cette dernière reste facultative, les délais de traitement du dossier sont raccourcis car la Drac a déjà eu connaissance du dossier en amont de la procédure.
Lorsque le préfet de région n'a pas répondu à l'issue du délai fixé, l'autorisation est considérée comme accordée.
Précision : le préfet de région peut assortir sa décision d'autorisation de prescriptions ou de réserves et préciser les conditions du contrôle scientifique ou technique par les services chargés des monuments historiques.
Attention : l'autorisation délivrée est caduque si la commune ne réalise pas les travaux dans les 3 ans suivant sa notification, ou son accord tacite, ou lorsqu’elle suspend les travaux pendant plus d'1 an. L'autorisation peut être prorogée d'1 an, si la demande de prorogation est adressée 4 mois avant l'expiration du délai de validité.
2 – Le cas d’un immeuble inscrit
L'obligation d'obtenir une autorisation d'urbanisme peut concerner les travaux portant sur :
- un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,
- un immeuble adossé à un immeuble classé, c'est-à-dire en contact avec cet immeuble (en élévation, au sol ou en sous-sol), ou une partie non protégée d'un immeuble partiellement classé,
- un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, s'il est visible du monument, ou visible en même temps que lui, et situé à moins de 500 m du monument,
- un immeuble situé dans un périmètre de protection adapté ou modifié.
Selon la nature des interventions (réparation, modification, démolition ou restauration), les travaux sont soumis soit à permis de construire, soit à permis de démolir, soit à permis d'aménager, soit à déclaration préalable.
Attention :
- la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable doit intervenir après l'accord du préfet de région,
- pour les travaux portant sur un immeuble inscrit ne nécessitant pas d'autorisation (permis ou déclaration préalable), la commune doit avertir les services de l’État 4 mois à l'avance.
La commune doit choisir un maître d'œuvre dans le cadre d’une mise en concurrence
Pour tous les travaux importants menés sur un édifice classé, la commune doit faire appel à un architecte compétent (décret 2009-749 du 22/06/2009 relatif à la maîtrise d'œuvre des édifices classés parmi les monuments historiques) ; pour cela, la commune doit lancer une procédure de mise en concurrence pour un marché de maîtrise d’œuvre.
Précision : cet architecte peut être soit un architecte en chef des monuments historiques, soit un architecte français ou européen titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention « architecture et patrimoine » ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Pour les travaux complexes ou dépassant le cadre de simples réparations, l’architecte doit justifier d'une expérience de dix années dans le domaine du bâti ancien.
Attention : avant de notifier le marché de maîtrise d'œuvre, la commune doit solliciter l'avis du préfet de région.
Les missions que la commune peut confier au maître d’œuvre
- La mission de diagnostic : cette mission comporte une description et une étude historique du monument, une couverture photographique, des plans et relevés, une évaluation de l'état sanitaire du monument et des travaux à réaliser.
Précision : la commune peut solliciter la Drac pour obtenir un co-financement de ce diagnostic.
- La mission de base : cette mission comporte les 6 éléments suivants :
1. les études d'avant projet, décomposées en avant projet sommaire et avant projet définitif ;
2. les études de projet ;
3. l'assistance apportée à la commune pour la passation du marché de travaux ;
4. l'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par l'entrepreneur et leur visa ;
5. la direction de l'exécution du marché de travaux ;
6. l'assistance apportée à la commune lors des opérations de réception pendant la période de parfait achèvement.
Attention : la commune doit également faire appel à un coordonnateur d'hygiène et de sécurité s'il y a co-activité de plusieurs entreprises sur le chantier. Pour les opérations complexes, elle peut également faire appel à un intervenant extérieur pour la mission d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC).
L’exécution et l’achèvement des travaux
Les services communaux doivent afficher l'autorisation de travaux sur un immeuble classé (ou l'autorisation d'urbanisme sur un immeuble inscrit) de manière visible de l'extérieur pendant la durée du chantier ; de plus, les services communaux doivent rédiger une déclaration d'ouverture de chantier avant le début du chantier.
Précision : les travaux sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'État chargés des monuments historiques (Drac).
Attention : en cours de chantier, toute modification de la nature et de l'importance des travaux doit faire l'objet d'une demande d'autorisation nouvelle.
Lorsque les travaux s’achèvent, la commune doit procéder au récolement des travaux, c'est-à-dire à la vérification sur place de la conformité des travaux avec l'autorisation de travaux ; cette opération doit se mener en collaboration étroite avec la Drac.
Attention : la commune doit veiller à ce que le maître d’œuvre lui remette le dossier d'ouvrages exécutés (DOE) en 4 exemplaires ; la commune doit en transmettre 3 exemplaires au service territorial de l'architecture et du patrimoine (Stap). C'est à partir de la remise du DOE que la Drac peut constater la conformité de l'exécution à l'autorisation donnée, dans un délai de 6 mois.
Ensuite, le préfet de région rédige un certificat de conformité des travaux ; ce document permet à la commune d’obtenir le versement du solde des éventuelles subventions.
Le financement des travaux
En tant que maître d'ouvrage, la commune doit assurer le préfinancement des travaux. Cependant, elle peut les répartir sur plusieurs exercices budgétaires en fonction d'un programme divisé en tranches fonctionnelles.
Afin de minimiser la charge dans le budget communal, le maire peut solliciter des aides financières de l'État (Drac, dotation d’équipement des territoires ruraux…) et des collectivités territoriales (région, département, EPCI…), qui sont attribuées sous certaines conditions, et, éventuellement, des aides des fondations ou des entreprises privées dans le cadre du mécénat (ce dernier permet aux entreprises comme aux particuliers d'aider financièrement à la conservation des monuments et œuvres d'art protégés au titre des monuments historiques et de déduire cette aide de leur imposition).
Précision : le financement des travaux sur les monuments historiques n'est pas soumis au seuil des 80% de financement public qui régit les autres plans de financement.
Pour les monuments classés, il n’existe pas de taux maximum pour la participation financière de l'État. En pratique, elle dépasse rarement 40 % à 50 % du coût HT des travaux.
Pour les immeubles inscrits, la participation de l'État est limitée à 40 % maximum de la dépense subventionnable. En pratique, elle se situe généralement entre 10 % et 20 % du coût des travaux.
Attention :
- la dépense subventionnable concerne les travaux de restauration, de réparation ou d'entretien, à l'exclusion de tous travaux d'extension ou d'aménagement neuf ;
- la subvention de l'État n'a pas de caractère obligatoire et peut être attribuée en fonction de plusieurs facteurs : disponibilités budgétaires, urgence de l'opération, capacités contributives du porteur du projet, participations éventuelles d'autres collectivités, ouverture au public...
Précision : la commune peut également solliciter certaines associations et fondations (parmi lesquelles la Fondation du Patrimoine, la Sauvegarde de l'Art Français).
Recourir à un marché à tranches conditionnelles pour lisser les travaux sur plusieurs années
Pour lisser des travaux importants affectant un immeuble sur plusieurs exercices comptables, la commune peut recourir à des marchés à tranches conditionnelles (art. 72, code des marchés publics). Ces marchés comportent une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. La commune définit dans son marché la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations de chaque tranche.
Intérêt : ce type de marché permet le lancement d'une consultation pour la réalisation d'un programme, en offrant aux candidats potentiels une bonne visibilité sur l'ensemble de l'opération. La commune peut, quant à elle, étaler financièrement dans le temps un programme important.
Attention : les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du maire, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché.
Le marché à tranches peut se traduire par la mise en œuvre d'une autorisation de programme et de crédits de paiement (AP/CP)
Le marché à tranches peut trouver une traduction budgétaire grâce à la technique budgétaire et comptable des AP/CP. En effet, afin d’avoir une vue pluriannuelle du budget communal, le conseil municipal peut voter des autorisations de programme en section d’investissement (art. 2311-3, CGCT).
Intérêt : cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l'exercice.
• Les autorisations de programme (AP) sont définies comme la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Le conseil municipal peut les réviser à la hausse comme à la baisse, voire modifier la durée de l’autorisation.
• Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP correspondantes.
Sources : direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) ; ministère en charge de la Culture et de la communication ; Drac.
Ludovic Vigreux le 02 septembre 2015 - n°54 de La Lettre des Finances des communes de moins de 2000 habitants
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline